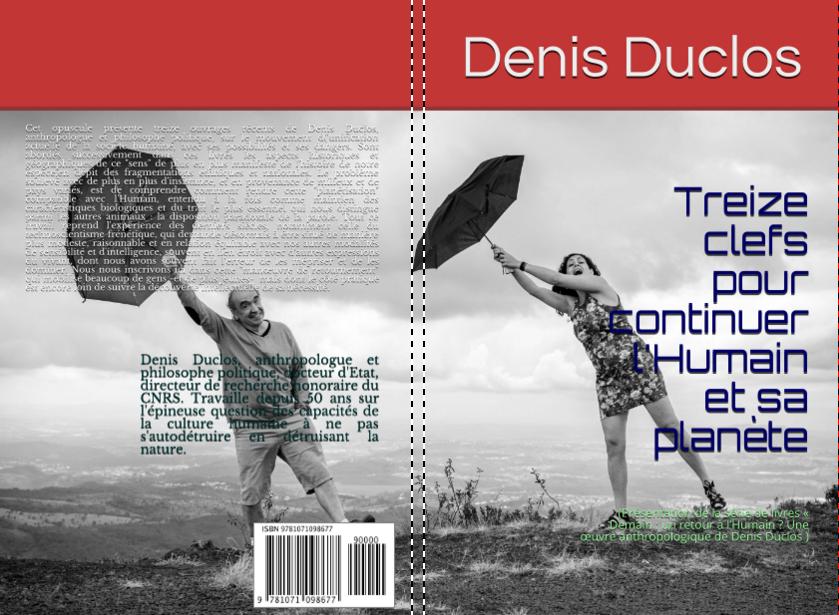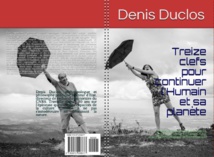présentation de la série (le volume comporte des présentations de chaque livre)
Le sens de l'œuvre
A l'heure où se répand un gigantesque fatras de publications sur la « catastrophe » écologique en cours (souvent commis par des auteurs demeurés plutôt indifférents au problème pendant des années), il me semble juste de présenter ce travail d'une décennie (préparé par un quart de siècle en tant que directeur de recherche au CNRS). Cet effort tente, en effet, d'articuler les dimensions multiples qui, séparément, rendent ordinairement paradoxales ou caduques les critiques et les solutions proposées dans l'urgence ou l'exaltation.
Par exemple, parsemer les paysages d'éoliennes flashantes de 250 m de hauteur pour contribuer à la « décarbonisation », n'est-ce pas en même temps détruire des éléments essentiels de la « joie de vivre » (lignes paysagères, nuits étoilées, silence, présence d’oiseaux, etc.), favoriser encore l'industrie lourde en empêchant le développement du petit éolien, gruger les participants à la mise de fond pour un rendement très aléatoire et finalement faible, et renforcer le « maillage » international des réseaux électriques au détriment du « local » (où les maisons ne vaudront plus rien, et la solidarité politique sera détériorée au profit de quelques propriétaires terriens et de leurs affidés municipaux) ?
Laisser rêver des « géo-ingénieurs » projetant d'enfouir des millions de tonnes de carbone sous terre, ou d'ensemencer les nuages de particules censées atténuer l'effet de serre , n'est-ce pas toujours favoriser la folie industrielle et capitaliste dont les menées ont précisément conduit à l'état actuel ?
Allons plus loin : une écocratie mondialiste ordonnant nos comportements alimentaires, vestimen-taires, nos déplacements, nos chauffages, etc, ne risque-t-elle pas aussi à terme, en suivant les conseils de savants aréopages, d'aboutir à une gestion concentra-tionnaire de la population humaine accusée de tous les maux ? Pourquoi n'en viendrait-elle pas aussi, du même élan moralisateur, à régenter nos ébats amoureux pour en surveiller la fécondité, à décider à notre place de notre « bien », ce dernier pouvant finalement être synonyme « d'évacuation » d'un excédent de personnes considérées inutiles (puisque, de toutes manières, une décroissance dûment technologisée détruirait une grande quantité d'emplois de qualité ) ?
Certes, nous y allons un peu fort . C'est que l'expérience historique peut conduire à une certaine prudence quant il s'agit de la confiance à accorder à nos élites. Il vaut peut-être mieux, plutôt que de nous préparer à « l'effondrement » généralisé, sous la houlette empressée de nouveaux missionnaires fanatiques, prendre le temps de réfléchir à l'ensemble des questions soulevées par cette « arrivée » de l'espèce humaine au stade d'une culture planétaire. C'est ce que nous avons entrepris, le plus calmement possible, mais parfois aussi en nous amusant ou en nous indignant, en dialoguant avec de nombreux membres d'une intelligentsia en désarroi, frères et sœurs en esprit, plus ou moins déboussolés mais ne sachant faire autre chose, quoi qu'il en soit, que de penser librement et avec application.
Le propos général de cette « série » n'est donc ni de vous faire la leçon, tel un Savonarole, un Pablo Servigne ou un Vincent Mignerot, un Yves Paccalet ou un Pierre Henri Castel, d’autres, sur la bonne façon de terminer notre histoire, ni de vous faire périr prématurément d'ennui à la lecture de recettes de survie ou à celle de jugements péremptoires sur les défauts de notre espèce. En revanche, nous avons un peu profité de l'ambiance millénariste que le GIEC et d'autres institutions de la Peur (Tromocratie selon Michalis Lianos) ont réussi à répandre sur la planète, pour procéder à une sorte d'examen de conscience sociologique et anthropologique sur le cheminement accompli jusqu'ici par le genre humain depuis qu'il l'est devenu (humain). Ce que nous datons arbitrairement -mais pour de bonnes raisons- des commencements de la parole (moins de cent mille ans, très plausiblement).
A notre propre échelle personnelle, nous avons pris beaucoup plus de temps pour réaliser cette réflexion tissée d'histoire et de philosophie, de psychanalyse, de sémiotique et de science politique, que Yuval Harari n'en a mis pour éternuer sa massive prédiction transhumaniste sur l'avenir robotique et scientiste, et nous ne disposons pas de l'appareil promotionnel et éditorial dont il a bénéficié.
Notre approche est donc beaucoup plus lente au niveau des fondations mêmes de la pensée. Elle a exigé une somme considérable de recherches de toutes sortes, et en premier lieu, de celles concernant la légitimation de notre propre point de vue. Le résultat attendu est donc devenu possible : les treize livres dont nous proposons la lecture peuvent être largement décrits comme les applications d'une démarche systématique, non au sens d'un « système philosophique », mais d'une exploration méthodique, poussée, en direction de chaque coin d'ombre, de chaque interrogation persis-tante ou récurrente, et cela dans des domaines excédant une spécialisation quelconque en termes de « médailles universitaires ». Nous sommes, de fait, très heureux d'en avoir terminé, alors qu'il nous reste peut-être quelques années à vivre dans un état sanitaire correct. Merci pour l'auteur, et aussi pour le statut de chercheur CNRS qui a permis d'éviter le « burning out » au cours d'une telle entreprise au long cours.
La ligne générale de l'ensemble des ouvrages peut être ainsi résumée : le genre humain est seul à être assujetti à la parole. Celle-ci nous change en espèce « virale », puisque chaque propos, chaque idée, chaque mot, peuvent être cités, reproduits, répétés jusqu’à ce qu’il aient littéralement fait le tour de l’humanité (au moins potentiellement). Ses effets sont donc bien potentiellement massifs, voire… catastrophiques. Or la parole n'est pas « un savoir », même si elle en produit obligatoirement. Elle est un « acte » qui engage chaque auteur, ainsi changé en « sujet », en assujetti. Mais, du seul fait que nous sommes assujettis à la parole comme devoir réciproque, nous le sommes aussi à la liberté de tout parleur authentique du choix de son discours et à son corollaire : l'indétermination des garanties ultimes de son propos. Nous nous engageons certes sur de la détermination, la catégorisation proposée à nos interlocuteurs (« ceci est cela »), mais c'est toujours un engagement, c'est-à dire une « avancée » dans l'inconnu, l'imaginaire, le sensible, la métaphore, le symbole précaire, jamais réductible à la chose et donc à jamais « inapproprié », ceci à nos risques et périls.
Bien sûr, nous pouvons encore, dans le dialogue, dans la controverse, préciser suffisamment nos dires pour approcher un « savoir absolu ». Mais l'acte de parole lui-même n'existe que parce qu'il a toujours lieu « en amont » d'un savoir. Cet acte -posé seulement entre personnes « physiques »- lui est irréductible, et notre savoir à nous, anthropologues, est de rappeler à tous les cognitivistes, à tous les vieux bambins en blouse blanche dans les laboratoires, qu'il doit tenir compte du fait que l'espèce humaine parlante ne l'est qu'en s'engageant au delà d'un discours, sans jamais pouvoir en évaluer exactement le risque, notamment le risque d'erreurs.
Cette reconnaissance de la spécificité de l'Humain (à la fois animal et parlant) a des implications fondamentales, et en particulier celle-ci : la disposition à parler comme acte, comme engagement réciproque, forme toujours des conversations, des controverses, et ces dernières constituent des cycles, parce qu'elles commencent, continuent et finissent par se clore.
Leurs débuts en sont toujours plus proches de l'acte de parole vive, parce qu'ils se déploient autour de ce qui est inconnu des protagonistes, et implique leur engagement libre. Tandis que leur clôture marque aussi un étiolement et une pétrification, consécutifs d'une entente toujours plus instituée, encadrée, réglementée, et prétendant saisir le réel lui-même dans sa rationalité. A la fin d'un cycle de parole, il n'existe plus qu'un discours officiel très précisément calibré, sans aucun écart, et donc sans « sujet » à la parole, lequel devient, par contraste, un pur objet de scandale.
Ces cycles -qui existent à n'importe quelle échelle de conversation, -y compris la grande conversation orchestrale qu'on appelle « Histoire »- correspondent donc, nous en soutenons l'hypothèse, à des mouvements allant d'une ouverture vers une fermeture, d'un moment de comparaison à un moment d'affirmation unaire, d'une antithèse vers une synthèse, d'une métaphore vers une catachrèse et une autoréférence, au delà de quoi, la conversation s'arrête, implose... et recommence sur d'autres bases.
Cela peut sembler hégélien en diable, sauf à considérer que le moment premier est d'emblée une opposition et que le moment dernier ne conduit pas automatiquement à une synthèse, un « aufhebung », mais bien plutôt à une implosion au delà de laquelle la parole reprend ailleurs que dans la « catégorie » (« condamnation » en grec) en tant que nouveau « rapprochement » (paravole), comparaison, métaphore vive, etc.
Nous concédons à Hegel, que la reprise peut se situer à une échelle supérieure et le fait le plus souvent, mais certainement pas en tant que « synthèse », laquelle est invivable, parce que l'être total qu'elle implique détruit toute parole possible (retour à l'animalité -sans la sensibilité entre individus- ou progrès vers la robotisation).
Nous vivons une période d'unification mondiale, donc de synthèse, d'autoréférence en formation -malgré les palinodies du trio Trump-Poutine-Xi-Jin-ping- Nous devons du même coup nous attendre, selon la théorie du cycle de parole, à un effondrement... de l'autoréférence mondialitaire en cours d'affirmation, et à un retour à une pluralité positionnelle permettant la parole. Cependant, la mondialité étant le symbole efficace du moment, il n'est pas question de retour au stade des nations ou des villes et de leurs anciens empires. La pluralité qui vient (et non l'insurrection ou le mal selon les Tarnacquiens ou Pierre-Henri Castel) sera incarnée comme contre-partie de cette mondialité, de cette universalité, et en un sens, la préservera comme condition de sa propre existence.
Comment cette pluralité naîtra-t-elle, que sera-t-elle ? Nul ne le sait de science sûre. En revanche, nous sommes en mesure de suggérer des processus vraisemblables ou même probables, avertis que nous sommes des types de solutions choisis dans le passé, lors d'épisodes -non pas homologues, car il n'a jamais existé de société pleinement planétaire avant la nôtre- mais au moins similaires dans certaines limites.
Notre hypothèse anthropologique, un peu folle, certes, est que le temps comme l'espace produisent chez les Humains parlants des structures de conversations qui tendent à évoluer plus ou moins rapidement entre des contraires et leurs médiations, vers des dominations (des métonymies), puis vers des apurements tel que seul reste en lice un unique système symbolique, avant que ce dernier, insupportable, n'implose à son tour.
Dans ce mouvement, l'espace est plutôt un « retardateur », car la simultanéité des opposés « géopolitiques » qu'il représente fascine et forme l'instrument d'une tradition résiliente à des changements rapides de signifiants. Au contraire, le temps enregistre des transformations sensibles et ininterrompues, qui prennent souvent la forme du maintien apparent des signifiants et du changement de leurs significations. Par exemple, le mot « société » renvoyait, dans l'Empire romain, aux « compagnons » des citoyens, ces derniers étant seuls réservataires de fonctions publiques, tandis que désormais il comprend « tous » les membres du collectif le plus vaste. Ainsi, dans la bouche du président Obama, le mot « société » désignait-elle directement le genre humain vivant sur la planète. Les reculs constatables aujourd'hui sur ce point ne le remettent pas vraiment en cause. Il y a bien une société-monde, et c'est sans doute notre principal problème.
Ce fait massif que nous sommes les premiers à vivre depuis, en gros, le début du troisième millénaire, implique un constat « historial » : le temps de notre récit le plus « orchestral » l'emporte sur toutes les fixations spatiales. Ce n'est d'ailleurs que la traduction ou la translation dans la culture d'une loi physique : celle de l'irréversibilité temporelle. Par exemple, l'Empire romain et l'empire chinois savaient déjà exister comme en miroir, médiatisé par les comptoirs indiens. La bipolarité Occident-Orient était déjà manifeste au plan d'une mondialité. Néanmoins, c'était celle d'empires urbains qui n'avaient pas encore pu accéder au stade de territoires nationaux, ni à celui de leurs projections capitalistes, technologiques et populationnelles.
Bien sûr, l'universalité « urbaine » s'était profon-dément engagée dans la direction allant d'une pulvérulence de relais dominés vers une unité sociétale (avec les édits de Caracalla accordant la citoyenneté romaine à tous les habitants libres de l'Empire) mais au prix d'une rupture sociale (entre honestiores et humiliores). Cette faille « simplifiée » avait poussé à son tour à l'adoption d'une idéologie homogène de l'égalité Père/Fils, laquelle, n'avait pu triompher cepen-dant que dans la complexité de la théologie trinitaire. Le schisme toujours en suspens se mit à attendre son heure puis explosa sous le prétexte des invasions barbares et remodela l'Empire en le divisant, cette fois entre un espace des peuples et un autre des cités.
A noter : à peu près au même moment la Chine s'installait, avec maints cahots et reculs, dans l'unification progressive (sous la férule des Han, des Jin et des Sui) à partir de la division entre ses royaumes précédemment « combattants », période de la plus grande pluralité et polycentralité chinoise sur tous les plans, avant que ne s'imposât la théorie de l'espace commun homogène (la tianxia).
Résultat global transrégional : la « conversation impériale urbaine » a produit des implosions relativement similaires de la Bretagne aux côtes chinoises, inventé des « Etats barbares » en pointillés, mais surtout choisi des villes-capitales bien mieux situées, servant de carrefours commerciaux et industriels à des fragments plus opérationnels de leurs « civilisations » respectives. Ainsi, à l'Ouest de l'Eurasie, de l'ancienne Byzance devenue pour un millénaire encore une meilleure Rome que la première, bien plus riche, en tout cas, et rendant sa chance à l'héllénisme qui avait fondé la koiné des cités méditerranéennes bien avant la latinité.
Le temps, donc avait ruiné un premier universalisme, tout en préparant dans la division et la « barbarie » (si bien réhabilitée par James C. Scott ou J.P. Demoule) le passage à la logique impériale-nationale, si tardivement théorisée par E. Hobsbawm, I. Wallerstein ou désormais A. Bihr (notre historien méconnu du mercantilisme).
La conversation représentée par cette « aire des empires » cette fois réellement mondialisés a bien commencé -il y a à peine cinq siècles- par des divisions formant autant de propositions en compétition, voire, bien sûr en guerres sanglantes, en massacres se rapprochant par crans du génocide. Mais qui a dit qu'une conversation devait être pacifique et douce ? Les tueries n'ont pas empêché le processus inéluctable de l'unification quasi-darwinienne de la discussion sous l'égide du « plus fort », jusqu'à ce que la base nationale nécessaire aux débuts de la vague finisse par se révéler nettement insuffisante : nous avons alors commencé à vivre dans le « post-empire » notamment signalé par E. Todd. La synthèse autoréférente était en marche, rassemblant de plus en plus souvent une ronde de dirigeants internationaux tous vêtus exactement du même complet-veston et de la même cravate, (nonobstant les préciosités des cols mao et iranien, ou du djilbab saoudien) photographiés dans les mêmes étreintes officielles sur les mêmes estrades du théâtre mondial, dédiés aux mêmes concepts d'une même conversation médiatisée sans trêve. Ce qui n'empêche certes pas, en coulisse, les manipulations d'armes de destruction carrément continentale, à la mesure de l'enjeu « terminal ». Celui du « dernier mot » et de son « point final ».
Cette vue cavalière -explorée plus en détail au cours des ouvrages présentés !- dévoile bien un sens, en dépit du mécontentement des historiens professionnels collés sur « leur » époque comme des bernicles universitaires prétendant s'approprier la temporalité : précisément celui de l'unification planétaire de la culture humaine, sous-tendu à l'évidence (de plus en plus manifeste) par ce qui, dans cette culture, y est irrésistiblement poussé, contrairement à toutes les autres espèces (qui vont d'ailleurs y laisser la peau). Or, qu'est-ce qui pousse irrésistiblement à l'unification dans la culture humaine, sinon le processus conversationnel de la parole ?
Si cela est vrai, néanmoins, ce qui nous entraîne en ce sens, est également chargé d'un paradoxe auto-destructeur, puisque plus nous parvenons à un stade universel, et plus la parole comme acte « performé » par des sujets individuels singuliers va résister devant son propre anéantissement dans la masse homogène et son discours standard, le fameux « pourtoussisme » du Bien médiatique et de sa censure virale automatique. Le problème est alors de savoir si cette inévitable réactivité de la culture sur elle-même dans un contexte de clôture universelle de la parole, va, un peu à la façon d'une inflammation auto-immune, nous soigner… ou nous rendre encore plus malades. C'est en essayant de répondre à cette question cruciale que nous avons cru comprendre que la « pluralisation » se présentant à l'horizon de notre actuelle mondialité pouvait se révéler salvatrice, et cela non seulement pour le maintien de l'Humain dans la parole vive qui le caractérise, mais aussi pour la planète vivante qui est son unique monde.
La pluralisation en devenir, celle qui fera « face » à la mondialité actuelle comme son antagonique pertinent, son opposé métaphorique, ne peut, en effet, que briser le glacis imposé par le système organique mis en place universellement à la place des empires. Cet organisme-monde très actuel, nous l'envisageons comme un personnage monstrueux, unifiant d’une seule voix et par une seule voie, les quatre cavaliers apocalyptiques résultant chacun d'une totalisation de la puissance dans leur domaine : le pouvoir gouvernemental et administratif, la technologie, l'argent (dont seul pour le moment Aldo Haesler a saisi le caractère littéralement eschatologique) et enfin la masse des Humains fascinée par elle-même. Nous avons, faute de mieux, étiqueté cette bête composite du néologisme affreux de Poutecharma , mot-valise affligeant dont la seule utilité est de rappeler à chaque occurrence qu'il s'agit bien d'une composition organique à laquelle rien ne doit manquer pour une bonne compréhension de ce phénomène agglutinant et préhensile, sorte de cancer culturel au stade avancé.
Il est en effet important de saisir, en s'appuyant sur la théorie de la parole comme armature de l'histoire humaine, que la visée d'autoréférence paradoxale qui nous fait tous courir infléchit en même temps les différents modes de notre existence et pas seulement certains, trop facilement désignables comme boucs émissaires.
Il est désormais bien reconnaissable que la critique marxiste de l'argent, une fois coupée de celle du pouvoir, et surtout de celle de la technologie, sans parler d'une sorte d'exonération de la masse supposée « bonne » par essence, a conduit aux erreurs assez monstrueuses du stalinisme et du maoïsme (y compris dans leurs incidences génocidaires parmi les Khmers rouges).
Et pourtant, nombre d'intellectuels persistent et signent : pour eux, seul, au fond, le « capital » serait notre ennemi. C'est que leur mode de pensée sommairement binaire leur chuchote que ce serait déchoir vers la droite en acceptant, même du bout des lèvres, de rejoindre Von Hayek dans sa critique de la bureaucratie étatique si pleine de bonne volonté « sociale ». Il serait aussi indigne, d'après leurs critères de bourgeois rouges, de critiquer la technologie et ses bienfaits libérateurs, et d'aller se perdre dans de misérables ZAD si marginales et si puantes de fumettes et de fumiers permacultivés.
Quant à la masse, celle des majorités urbaines et laborieuses, il n'est pas question une seconde d'oser salir son image de sainteté collective, de ventre de bouddha féminisé et universalisé. Or, hélas, il faut être clairs : sans un consentement -non seulement à la servitude volontaire la-boétienne mais au meilleur des mondes selon Huxley-, sans désir de masse poussant devant lui les élites, il n'y aurait pas l'énergie suffisante pour toujours plus de « novlangue », et d'abêtissement concerté dans les jeux du cirque internétisé. Sans masse -au sens canettien du terme- il n'y aurait ni accumulation capitaliste, ni surdimensionnement techni-que, ni pouvoir administratif invasif, aussi bien par voies privées que publiques, par corsaires informatiques et GAFA (ces compagnies des Indes post-modenres), ou par oukases étatiques imposés aux moments adéquats par des Raminagrobis toujours à l'affût.
En revanche, une fois bien compris le caractère organique, intriqué à toutes les échelles, de ces quatre dimensions de la même tendance à l'unification autoréférente, il devient enfin possible d'envisager où et comment la pluralisation inéluctable (en tant que retour à la parole échangée) prendra effet comme décomposition du poutecharma (ce discours univoque, algorithme chassant l'Humain de la parole elle-même)
Ce retournement vers la base vivante de la culture humaine ne peut en effet que signifier une implosion de la monstrueuse organicité, laquelle serait d'abord implo-sion de chaque dimension constitutive. Ainsi, la centralité, comme l'avait déjà pressenti Tocqueville, doit être détruite sans remords ni prévention par l'autonomie et la souveraineté communales , lesquelles ne pourront le faire qu'en remaniant le paradoxe qui les oppose à l'universalité des réseaux informatisés. Peut-être sera-ce possible par des consultations directes, contournant l'existence d'une classe politique devenue inutile, mais surtout par l'organisation d'une présence physique « tournante » dans le contrôle des instances mondiales résiduelles.
La technologie, une fois renvoyée à sa fonction de prolongement direct des corps vivants et actifs, devrait alors abandonner son rôle de fabricant de drogues de masse, qu'elles soient chimiques, fictionnelles ou informationnelles. Elle induirait donc beaucoup moins de pollutions intrinsèques et périphériques.
L'argent, ne pouvant plus être accumulé en gigantesques concentrations financières puisque la souveraineté et l'autonomie communales interdiront sa pénétration déstabilisante au plan local, ne saurait plus non plus préparer l'invasion du monde par des vagues technologiques de plus en plus éco-prométhéennes, dépensières et polluantes. Il ne pourrait plus « remplacer » l'activité pour soi et ses proches par une aliénation concentrationnaire et la fabrication d'une élite artificielle, une hyperclasse de bobos mondialisés grâce aux tunnels aériens (non seulement bourgeois bohèmes, mais aussi « bons » et « beaux » comme se croyaient les aristocrates antiques en fin de race : Kaloï ke Agathoï). Enfin, et surtout, la masse comme miroir identificatoire se briserait en autant de dignes communautés, et les « gens » qui en sortiraient vivants, pourraient enfin se prendre pour de nobles auteurs de paroles engageant leur honneur et leur plaisir, plutôt que pour des numéros sur des listes de données mondialisées. Ce qui ne les empêcherait pas de participer, les uns après les autres (en détruisant les faux concepts de « personne morale », de « représentation », et de « permanent ») à l'activité politique planétaire aussi bien qu'à la discussion interne de leur communauté souveraine.
Constater le caractère utopique de nos pronostics n'enlève rien à leur valeur, puisque ce caractère lui-même n'est que l'état général sous-jacent de la conversation orchestrale mondialisée.
Un bouillonnement encore discret se déploie en ce sens, et nous ne devons pas nous leurrer sur le caractère marginal de la « galaxie des autonomes » (qui parviennent néanmoins à vaincre des monstres capitalistes comme Vinci), la faiblesse des individus isolés (qui forcent déjà Bayer à leur verser plus d'un milliard pour une maladie causée par le Roundup de Monsanto), ou encore l'hésitation pataude des présumés « beaufs » que seraient les gilets jaunes (systématiquement décrétés « en recul » chaque semaine par les médias institutionnels). Ceux qui misent sur la marginalité, la faiblesse et l'inhabileté politicienne et s'en gaussent feraient mieux de vendre au rabais leurs appartements parisiens de luxe et de préparer leurs bagages pour le jour où l'opinion basculera, contre toute attente. En effet, notre pronostic n'est pas un prophétisme, mais la déduction d'un modèle théorique qui fonctionne bien sur des échelles suffisantes de temps (bien sûr sans pouvoir prévoir l'année ou l'heure) : l'Humain, tel qu'en lui-même il se distingue des autres animaux par l'acte de parole, déteste autant la complétude de l'idéal réalisé que la nature a horreur du vide. Au contraire de cette dernière, le parleur a horreur du trop plein, de la saturation, de l'état stationnaire, de la résidence définitive, de la perfection, de l'ordre intégral , du zéro risque et du Bien absolu. Il leur préfère, comme le disait Rousseau, la « perfectibilité », la non quiétude, le mouvement permanent, et répond toujours par l'angoisse la plus irrationnelle à la seule perspective de s'arrêter (même si le retraité récent fanfaronne sur ce point, avant de sombrer dans la dépression et d'être contraint à la non-mort dans la non-vie de l'EHPAD). Et dans les conditions d'une mondialité parachevée par la finance et mise sous contrôle par la solidarité discrète des quelque 300 Etats de la planète, rester vivants en tant qu'Humains parlants, ne peut signifier qu'une seule chose : fracturer la gigantesque structure sociétale où nous nous sommes enfermés, et que le lapsus ordinaire nomme « effet de serre » en croyant l'attribuer au carbone réchauffant l'atmosphère (problème qui existe très réellement par ailleurs). L'objet même dudit lapsus (et de tant d'autres, noyés dans la soupe médiatique) n'est pas un hasard : nous voulons « respirer », à la fois physiquement et symboliquement, ce qui requiert plausiblement des actes sur les deux plans, ou peut-être même sur un plan transversal où les deux inquiétudes seraient dépassées d'un seul mouvement. Or c'est précisément possible dès lors qu'on se détourne, au plan personnel, familier et communal, de la dépendance extrême aux macro-systèmes de production et de consommation , dépendance cristallisée qui nous force en même temps à dépenser des sommes fantastiques en énergies polluantes et irrécupérables. Un nombre grandissant de personnes prennent conscience de ce fait dans le monde, mais elles ne tardent pas à rencontrer les limites, les lois, les normes, les règles, qui rendent notre confine-ment « obligatoire ». Encore que ces dernières n'avaient pu anticiper un éveil aussi rapide et aussi nombreux, et vont certainement donner lieu à des mises en place stratégiques et tactiques de dispositifs répressifs. Lesquels décourageront beaucoup de bonnes volontés. Mais au fond : les résistances aux plus grandes moments de changement de vent dominant ont-elles la moindre chance de triompher ?
L'apport de notre travail n'est pas, soyons en conscients, d'appuyer une dynamique des pratiques dont les enjeux importants et les énergies massives n'ont rien à voir avec tout ce qu'un intellectuel peut articuler. Il est peut-être au mieux d'apporter un petit peu de réconfort à ceux qui commencent à se détourner du poutecharma afin de restaurer la communauté où la parole libre est reconnue et porteuse de joie de vivre. Encore qu'un tel réconfort ne puisse exister que si le lecteur est convaincu de la vraisemblance et même de la probabilité du basculement de la culture humaine en direction de la pluralité des pratiques de vie collective autonomes et de la liberté réelle des personnes (notamment en termes économiques). Non, l'avenir n'appartient pas à la dictature (fût-ce celle du prolétariat), mais au sujet humain d'une parole libre, laquelle implique certains principes protecteurs, certaines conditions de maintien de sa souveraineté, associée à celle de sa communauté. C'est ce dont nous espérons convaincre le lecteur le plus vigilant.
Dans cet opuscule de présentation, nous proposons un guide « topologique » de la suite des livres, bien que chacun puisse préférer ordonner sa lecture comme il l'entend. Cette « carte » indiquant un périple possible se veut néanmoins faciliter la démarche, en particulier pour soutenir assez rapidement le passage d'une théorie (qui n'est pas si aisée à établir dans sa logique propre et à accepter (au moins provisoirement et sans bloquer pour autant la moindre critique) comme base de pensée de vastes processus complexes.
b[
 Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)
Commander des livres de Denis Duclos (études et essais)

 CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE
CRISE DU CAPITALISME ET CONSOLIDATION DU SYSTEME-MONDE